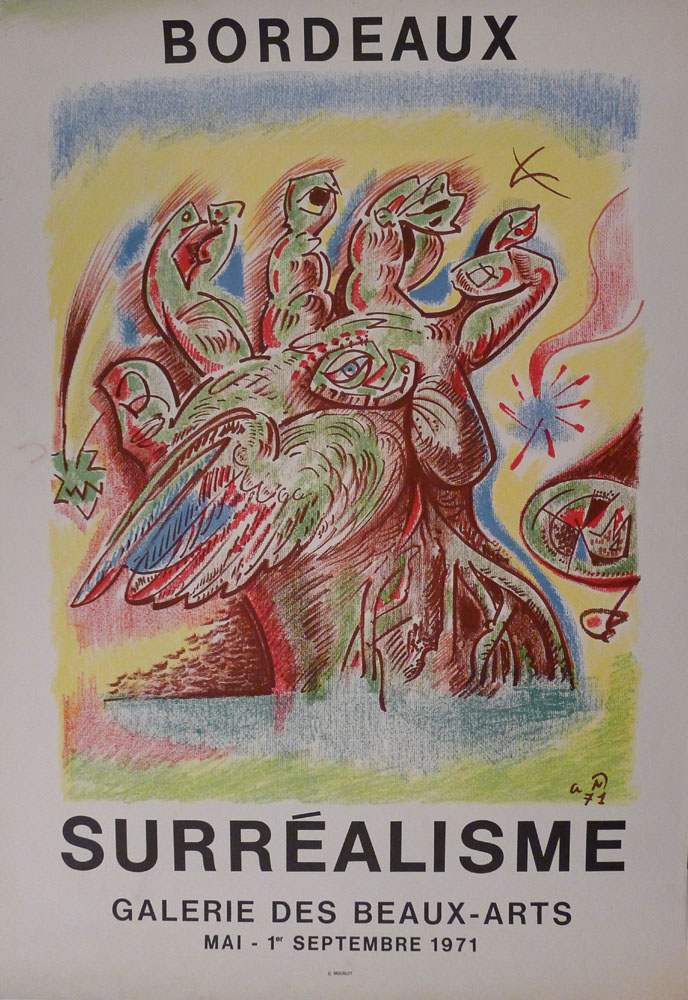Les expositions du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux depuis 1834
Gabriel ALLEGRAIN, "La Fuite en Egypte"
(Paris, 1679 – id., 1748)
La Fuite en Egypte
Vers 1716
Huile sur toile. Hauteur. 129 cm. Largeur. 162,2 cm.
Historique : Ancienne collection de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture.
Envoi de l’Etat en 1805.
Jean-Marc NATTIER, "Etude pour le portrait de Marie-Josèphe de Saxe"
(Paris, 1685 – Id., 1766)
Etude pour le portrait de Marie-Josèphe de Saxe
Vers 1750
Huile sur toile.
Hauteur 60 cm. Largeur 50 cm.
Historique : Ancienne collection royale. Achat par les musées royaux, 1839. Envoi de l’Etat, 1872.
Marianne LOIR, "Portrait de Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil, Marquise du Châtelet"
(Paris (?), vers 1715 – ?, après 1769)
Portrait de Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil, Marquise du Châtelet.
Huile sur toile.
Hauteur 118 cm. Largeur 96 cm.
Historique : Envoi de l’Etat, 1803.
Ce tableau a bénéficié d'une étude remarquable, écrite par G. Le Coat et A. Eggimaun-Besançon (1986). Grâce à des lectures iconographiques, biographiques et littéraires, les deux auteurs décryptent les circonstances et la date de cette œuvre et lui donnent une valeur emblématique. Par rapport aux autres portraits de la Marquise sans emblème, connus surtout par les gravures où elle est représentée comme une femme d'un certain âge, sans signe de coquetterie (bijoux, fleurs...), les portraits avec emblèmes comme le nôtre (cf. aussi celui de Nattier, 1743, non localisé, ou celui de Largilière, 1740, Colombus Museum of Art), se réfèrent à ses activités scientifiques, compas, globe terrestre, livres mais aussi à sa féminité, œillet, bijoux, toilette sophistiquée, et font ainsi exister l'intellectuelle et la séductrice. L'œillet symbole "de l'amour qui engage la chair" est tenu dans la main gauche, celle du cœur alors que le compas dans la main droite, intellectuelle, est en même temps un symbole mathématique et une idée de contrôle de soi ; faire quelque chose "sans compas" signifie au 18ème siècle "agir à tord et à travers". Les deux emblèmes sont en balance ; l'œillet est mis en évidence, éclairé, au centre de la composition alors que le compas est en bas de l'espace dans l'ombre. Cette femme mûre donne une priorité au sensuel sur l'intellectuel. Les dernières années de sa vie le démontrent avec sa liaison passionnée avec le jeune Saint-Lambert. En 1748, Voltaire écrit à son rival heureux une épître qui peut servir de commentaire au tableau :
"Elle a laissé là son compas,
Et ses calculs et la lunette,
Elle reprend tous ses appâts ;
Porte-lui vite sa toilette
Ces fleurs qui naissent sous tes pas...".
A la même époque, en 1749, elle écrit le Discours sur le bonheur dans lequel elle soutient que l'intellectuel est aussi bien l'apanage des femmes que des hommes, mais que la recherche du bonheur passe par la volupté amoureuse. Pour Gabrielle-Emilie l'étude et l'amour sont complémentaires : une intellectuelle ne cesse pas d'être une femme ; il faut rester en contact avec l'étude dont on ne peut être abandonné ; à cause de la précarité de l'amour, l'étude est bien "celle qui de toutes les passions contribue le plus à notre bonheur".
Marianne Loir en tant que femme "active" ne pouvait qu'adhérer à ce genre de portrait; on reconnaît volontiers son style, proche de celui de Pierre Gobert (1662-1774), dans le caractère statique et les visages toujours souriants. Elle est aussi proche de Nattier avec une "palette privilégiant le gris-perle, le vert la rose et le bleu et ses costumes historiés".
Jean II RESTOUT, "La Présentation de Jésus au Temple"
(Rouen, 1692 – Paris, 1768)
La Présentation de Jésus au Temple
Vers 1735
Huile sur toile.
Hauteur 407 cm. Largeur 275 cm.
Historique : Séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Envoi de l’Etat, 1805.
Henri-Horace ROLAND DE LA PORTE, "Nature morte à la vielle"
(Paris, 1724-1793)
Nature morte à la vielle
Vers 1760
Huile sur toile.
Hauteur 80,5 cm. Largeur 101 cm.
Historique : Ancienne collection Belay, 1872 ; ancienne collection Gardère ; legs de Théodore Gardère, 1903.
Jean-Faur COURREGE, "Vénus pleurant la mort d’Adonis"
(Paris, 1730 - Bordeaux, 1806)
Vénus pleurant la mort d’Adonis
Avant 1753
Huile sur toile. Hauteur. 130 cm. Largeur. 196 cm.
Historique : Salon de l’Académie de Saint-Luc, 1753, n° 213 ; ancienne collection Carraci, Bologne ; anciennes collections Ferrier, Dodd puis Cote, Montréal ; ancienne collection Keller, Westmount ; achat de la Ville avec la participation du F.R.A.M, 1991.
Jean-Joseph TAILLASSON, "Le Tombeau d’Elisée"
(Bordeaux, 1745 – Paris, 1809)
Le Tombeau d’Elisée
Avant 1774
Huile sur toile. Hauteur. 131 cm. Largeur. 159 cm.
Historique : Ancienne collection de l’Académie de Peinture, de Sculpture et d’Architecture de Bordeaux, 1774 ; ancienne collection de l’Ecole de dessin de Bordeaux, 1793 ; entrée au Musée en 1801.
Jean-Baptiste Greuze "L'Inconsolable"
(Tournus, 1725 – Paris, 1805)
L’Inconsolable
Huile sur toile. Hauteur : 45,7 cm. Largeur : 37,5 cm.
Historique : Collection du comte de Vaudreuil, vendue le 26 novembre 1787 (lot n° 100). Galerie Seligman, Paris. Collection Philip Lathrope Cable et Martha Kelly Cable. Collection privée, New York. Don de la Société des amis des musées de Bordeaux , 2014.
Johann Friedrich August TISCHBEIN, "Frédérique Louise Wilhelmine, Princesse d’Orange-Nassau"
(Maastricht, 1750 – Heidelberg, 1812)
Frédérique Louise Wilhelmine, Princesse d’Orange-Nassau
1788
Huile sur toile.
Hauteur 210 cm. Largeur 165 cm.
Historique : Achat de la Ville, 1970.
Thomas LAWRENCE, "Portrait de John Hunter"
(Bristol, 1769 – Londres, 1830)
Portrait de John Hunter
1789-1790
Huile sur toile.
Hauteur 244 cm. Largeur 148 cm.
Historique : Ancienne collection de Mme Buller Epsom, 1936. Ancienne collection M. Stanhope Shelton, 1956. Ancienne collection I.B. Atkins, 1988. Achat de la Ville, avec la participation du F.RA.M. Aquitaine, 1992.
Pierre LACOUR (Père), Vue d’une partie du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan
Bordeaux, 17 avril 1745 - Bordeaux, 28 janvier 1814
Vue d’une partie du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan
1804-1806
Huile sur toile
Hauteur 207 cm. Largeur 340 cm
Achat, 1872.
 Celui-ci fut bâti, à la fin du XVIIIe siècle, par l'architecte Dufart, pour le consul des États-Unis Joseph Fenwick. L'immeuble compte huit travées en façade, sur le Pavé des Chartrons mais nous n'en apercevons que sept en raison du point de vue choisi par Lacour. Au rez-de-chaussée, deux tilleuls, sous le feuillage desquels des promeneurs cherchent un peu d'ombre, encadrent l'entrée principale en plein cintre. Au premier étage, afin de conserver un peu de fraîcheur, les volets des baies ont été fermés. Sur le balcon, des enfants se dirigent en courant vers leurs parents, accoudés à la balustrade. Plus haut, l'étage dévolu aux domestiques se protège également des ardeurs du soleil. L'ombre portée d'un volet laissé ouvert vient se projeter sur le mur ensoleillé. Au-dessus de la toiture, se détachent les deux petits lanternons qui servaient d'observatoires au propriétaire des lieux, lui permettant de jouir agréablement à la fois de la vue et de l'activité portuaire. Le récent nettoyage du tableau a mis au jour les traînées de fumée qui s'échappent de l'une des cheminées. Leur présence nous laisserait très justement penser que Lacour a choisi de peindre son tableau en fin d'après-midi, c'est-à-dire au moment où le soleil commence à décliner et que le personnel domestique prépare le souper...
Celui-ci fut bâti, à la fin du XVIIIe siècle, par l'architecte Dufart, pour le consul des États-Unis Joseph Fenwick. L'immeuble compte huit travées en façade, sur le Pavé des Chartrons mais nous n'en apercevons que sept en raison du point de vue choisi par Lacour. Au rez-de-chaussée, deux tilleuls, sous le feuillage desquels des promeneurs cherchent un peu d'ombre, encadrent l'entrée principale en plein cintre. Au premier étage, afin de conserver un peu de fraîcheur, les volets des baies ont été fermés. Sur le balcon, des enfants se dirigent en courant vers leurs parents, accoudés à la balustrade. Plus haut, l'étage dévolu aux domestiques se protège également des ardeurs du soleil. L'ombre portée d'un volet laissé ouvert vient se projeter sur le mur ensoleillé. Au-dessus de la toiture, se détachent les deux petits lanternons qui servaient d'observatoires au propriétaire des lieux, lui permettant de jouir agréablement à la fois de la vue et de l'activité portuaire. Le récent nettoyage du tableau a mis au jour les traînées de fumée qui s'échappent de l'une des cheminées. Leur présence nous laisserait très justement penser que Lacour a choisi de peindre son tableau en fin d'après-midi, c'est-à-dire au moment où le soleil commence à décliner et que le personnel domestique prépare le souper...
 Le long du Pavé des Chartrons, l'immeuble Fenwick présente quatre travées. Au rez-de-chaussée, quatre portes monumentales donnent directement accès sur le quai. Plus loin, se dressent, le long de la courbe du fleuve, les maisons des négociants étrangers dont les balcons sont également occupés par leurs propriétaires. Chaque bâtiment comporte, en règle générale, un rez-de-chaussée réservé aux affaires et, en arrière, des chais et des entrepôts. Les étages supérieurs étaient, quant à eux, réservés au maître des lieux et à sa famille. En étudiant de manière plus approfondie la presse quotidienne de l'époque, il est intéressant de constater que la plupart des ressortissants américains est installée à proximité du consulat. Ainsi la maison Gray Et Hoskins se trouve juste à côté de celle de Fenwick. Plus loin, c'est-à-dire à quelques mètres de là, se tient le Café des Américains, dont on aperçoit, au-dessus de l'entrée, le nom en lettres jaunes sur fond rouge. Il s'agissait en fait d'un fonds de commerce appartenant à un limonadier, qui fut d'ailleurs mis en vente, le 1er brumaire an XIII (23 octobre 1804). Enfin le bureau de la loterie est signalé dans la presse sous l'adresse : « sixième maison après M. Fenwick ».
Le long du Pavé des Chartrons, l'immeuble Fenwick présente quatre travées. Au rez-de-chaussée, quatre portes monumentales donnent directement accès sur le quai. Plus loin, se dressent, le long de la courbe du fleuve, les maisons des négociants étrangers dont les balcons sont également occupés par leurs propriétaires. Chaque bâtiment comporte, en règle générale, un rez-de-chaussée réservé aux affaires et, en arrière, des chais et des entrepôts. Les étages supérieurs étaient, quant à eux, réservés au maître des lieux et à sa famille. En étudiant de manière plus approfondie la presse quotidienne de l'époque, il est intéressant de constater que la plupart des ressortissants américains est installée à proximité du consulat. Ainsi la maison Gray Et Hoskins se trouve juste à côté de celle de Fenwick. Plus loin, c'est-à-dire à quelques mètres de là, se tient le Café des Américains, dont on aperçoit, au-dessus de l'entrée, le nom en lettres jaunes sur fond rouge. Il s'agissait en fait d'un fonds de commerce appartenant à un limonadier, qui fut d'ailleurs mis en vente, le 1er brumaire an XIII (23 octobre 1804). Enfin le bureau de la loterie est signalé dans la presse sous l'adresse : « sixième maison après M. Fenwick ».
 En cette fin de journée, se pressent à la fois les charretiers et leurs attelages chargés de pierre, mais aussi les carrosses et les cabriolets, dont l'un des cochers tente de calmer sa monture. Des bornes protègent les promeneurs de tout danger lié au trafic. Plus loin, le spectateur peut distinguer les deux maisons jumelles, surnommées « maisons hollandaises », dont on aperçoit les pignons, derrière le bâtiment d'octroi. Enfin, la fontaine de forme pyramidale de la rue Raze, qui fournissait à l'époque une grande partie de l'eau potable au faubourg, reste encore visible au loin, à proximité d'un immeuble dont l'une des cheminées fonctionne à plein régime. Au-delà du quai des Chartrons, s'étend le quai de Bacalan, peuplé essentiellement de journaliers, de bateliers et de tonneliers, dont il est difficile de détailler les immeubles en façade.
En cette fin de journée, se pressent à la fois les charretiers et leurs attelages chargés de pierre, mais aussi les carrosses et les cabriolets, dont l'un des cochers tente de calmer sa monture. Des bornes protègent les promeneurs de tout danger lié au trafic. Plus loin, le spectateur peut distinguer les deux maisons jumelles, surnommées « maisons hollandaises », dont on aperçoit les pignons, derrière le bâtiment d'octroi. Enfin, la fontaine de forme pyramidale de la rue Raze, qui fournissait à l'époque une grande partie de l'eau potable au faubourg, reste encore visible au loin, à proximité d'un immeuble dont l'une des cheminées fonctionne à plein régime. Au-delà du quai des Chartrons, s'étend le quai de Bacalan, peuplé essentiellement de journaliers, de bateliers et de tonneliers, dont il est difficile de détailler les immeubles en façade. Derrière la balustrade, le spectateur peut apprécier cette foule bigarrée, qui vaque à ses occupations les plus diverses. Juste en arrière, Pierre Lacour nous offre un étonnant portrait de famille. À ce titre, la présence de la plupart de ses proches nous permet d'affirmer que ce tableau est également une œuvre testamentaire, dans laquelle l'artiste a voulu à la fois témoigner de son indéfectible attachement à la ville de Bordeaux et à son port, mais aussi et surtout son affection pour les siens.
Derrière la balustrade, le spectateur peut apprécier cette foule bigarrée, qui vaque à ses occupations les plus diverses. Juste en arrière, Pierre Lacour nous offre un étonnant portrait de famille. À ce titre, la présence de la plupart de ses proches nous permet d'affirmer que ce tableau est également une œuvre testamentaire, dans laquelle l'artiste a voulu à la fois témoigner de son indéfectible attachement à la ville de Bordeaux et à son port, mais aussi et surtout son affection pour les siens. Au second plan, Madame Combes, se promène, au bras d'Anaïs, sœur cadette de Lysidice. Enfin, de l'autre côté, à gauche, accoudé à la balustrade, Pierre Lacour fils, les cheveux coupés « à la Titus », conformément à la mode de l'époque, observe les deux portefaix sur la cale. Derrière lui, son oncle, le peintre en miniature Antoine Lacour, coiffé d'un haut de forme, regarde le spectateur.
Au second plan, Madame Combes, se promène, au bras d'Anaïs, sœur cadette de Lysidice. Enfin, de l'autre côté, à gauche, accoudé à la balustrade, Pierre Lacour fils, les cheveux coupés « à la Titus », conformément à la mode de l'époque, observe les deux portefaix sur la cale. Derrière lui, son oncle, le peintre en miniature Antoine Lacour, coiffé d'un haut de forme, regarde le spectateur. La balustrade de bois sépare les badauds et les promeneurs de l'activité proprement dite du port. Lors de son séjour à Bordeaux, en 1785, chez le consul Bethmann, Sophie de La Roche, qui contemplait depuis sa fenêtre, l'activité du quai des Chartrons s'étonnait du nombre considérable de « manœuvres, un millier environ », qui travaillaient sur la cale en pente douce. Dans les années 1804-1806, le va-et-vient continuel des corps de métiers, est toujours le même.
La balustrade de bois sépare les badauds et les promeneurs de l'activité proprement dite du port. Lors de son séjour à Bordeaux, en 1785, chez le consul Bethmann, Sophie de La Roche, qui contemplait depuis sa fenêtre, l'activité du quai des Chartrons s'étonnait du nombre considérable de « manœuvres, un millier environ », qui travaillaient sur la cale en pente douce. Dans les années 1804-1806, le va-et-vient continuel des corps de métiers, est toujours le même. Vers le quai des Chartrons, un charretier tente, à l’aide de quelques coups de fouets, de faire remonter son attelage chargé de pierres vers le haut de la cale, tandis que, plus en arrière, des barriques sont roulées sur le sol depuis une gabarre, puis tirées au moyen de cordes en direction des entrepôts. En arrière du bâtiment d'octroi, les ouvriers poursuivent les déchargements. Un agrandissement photographique du prolongement du quai des Chartrons permet d'apprécier le réalisme des scènes représentées. L'œil exercé peut repérer, çà et là, des personnages aux attitudes diverses et variées, circulant parmi les ballots de marchandises entreposés à même le quai, faute de place. Plus loin, se dresse la fontaine pyramidale de la rue Raze, qui servait à la fois de point d'eau pour les habitants des Chartrons mais aussi pour les vaisseaux en partance vers des terres lointaines.
Vers le quai des Chartrons, un charretier tente, à l’aide de quelques coups de fouets, de faire remonter son attelage chargé de pierres vers le haut de la cale, tandis que, plus en arrière, des barriques sont roulées sur le sol depuis une gabarre, puis tirées au moyen de cordes en direction des entrepôts. En arrière du bâtiment d'octroi, les ouvriers poursuivent les déchargements. Un agrandissement photographique du prolongement du quai des Chartrons permet d'apprécier le réalisme des scènes représentées. L'œil exercé peut repérer, çà et là, des personnages aux attitudes diverses et variées, circulant parmi les ballots de marchandises entreposés à même le quai, faute de place. Plus loin, se dresse la fontaine pyramidale de la rue Raze, qui servait à la fois de point d'eau pour les habitants des Chartrons mais aussi pour les vaisseaux en partance vers des terres lointaines.
 La plupart des voyageurs étrangers de passage à Bordeaux ont évoqué l'incessant va-et-vient de navires, gabarres, filadières et autres embarcations évoluant à proximité du port. Depuis sa fenêtre, plus exactement depuis son lit, Sophie de La Roche apercevait, en 1785, une forêt de mâts des navires [...], mouillés sur trois rangs et toujours à une certaine distance les uns des autres. Pareille disposition donne à l'ensemble un aspect d'autant plus magnifique et agréable que ces rangées de grands navires, aux mâts desquels flottent des pavillons si divers, éveillent vraiment en vous de grandes idées. » En 1788, le futur maréchal Brune faisait état de son étonnement, devant cette « forêt d'arbres fort élevés, dépouillés de leur verdure. Ce sont les mâts des vaisseaux des différentes nations qui commercent avec la capitale de la Guyenne. La variété des formes des bâtiments, les pavillons divers, l'activité des matelots sont, après la mer, ce qui m'a le plus étonné de ma vie. Hollandais, Anglais, Portugais, Génois, Français occupent tour à tour mes regards. Mille petits canots fendent les eaux à force de rames. »
La plupart des voyageurs étrangers de passage à Bordeaux ont évoqué l'incessant va-et-vient de navires, gabarres, filadières et autres embarcations évoluant à proximité du port. Depuis sa fenêtre, plus exactement depuis son lit, Sophie de La Roche apercevait, en 1785, une forêt de mâts des navires [...], mouillés sur trois rangs et toujours à une certaine distance les uns des autres. Pareille disposition donne à l'ensemble un aspect d'autant plus magnifique et agréable que ces rangées de grands navires, aux mâts desquels flottent des pavillons si divers, éveillent vraiment en vous de grandes idées. » En 1788, le futur maréchal Brune faisait état de son étonnement, devant cette « forêt d'arbres fort élevés, dépouillés de leur verdure. Ce sont les mâts des vaisseaux des différentes nations qui commercent avec la capitale de la Guyenne. La variété des formes des bâtiments, les pavillons divers, l'activité des matelots sont, après la mer, ce qui m'a le plus étonné de ma vie. Hollandais, Anglais, Portugais, Génois, Français occupent tour à tour mes regards. Mille petits canots fendent les eaux à force de rames. » Conformément aux témoignages retranscrits ci-dessus, les navires à forts tonnages, battant pavillons étrangers, mouillent au large, sur trois rangs. Ils sont maintenus à une certaine distance les uns des autres, afin d'éviter, d'une part, tout risque d'avarie au moment des marées mais aussi, et surtout, tout incendie qui pourrait se propager trop rapidement. Non loin, quelques galiotes, dont les voiles carrées ont été ferlées sur les vergues, attendent de décharger. L'une d'entre elles, venant des Amériques, la proue dirigée vers l'aval du fleuve, fait face à un navire russe, reconnaissable à l'aigle impérial figurant sur le pavillon placé à la poupe. Plus loin, un brick, toutes voiles dehors quitte silencieusement le port...
Conformément aux témoignages retranscrits ci-dessus, les navires à forts tonnages, battant pavillons étrangers, mouillent au large, sur trois rangs. Ils sont maintenus à une certaine distance les uns des autres, afin d'éviter, d'une part, tout risque d'avarie au moment des marées mais aussi, et surtout, tout incendie qui pourrait se propager trop rapidement. Non loin, quelques galiotes, dont les voiles carrées ont été ferlées sur les vergues, attendent de décharger. L'une d'entre elles, venant des Amériques, la proue dirigée vers l'aval du fleuve, fait face à un navire russe, reconnaissable à l'aigle impérial figurant sur le pavillon placé à la poupe. Plus loin, un brick, toutes voiles dehors quitte silencieusement le port...
 Une flotte impressionnante navigue autour des grands voiliers. Parfois, de petits canots le plus souvent à avirons, assurent le transport des voyageurs depuis les vaisseaux vers la berge. Quelques bateaux à voiles glissent sur le fleuve. Des filadières, reconnaissables à leurs carènes effilées, s'apprêtent à quitter le bord. À droite, l'équipage d'une yole lormontaise guinde le mât et s'apprête à appareiller. Lorsque l'embarcation aura quitté la rive, un filet, ou carrelet, sera immergé dans l'eau, afin de capturer les poissons de rivière. Plus au bord, des enfants profitent des joies de la baignade. Quelques barques, vidées de leur chargement sont échouées et attendent le changement de marée pour repartir. À l'aplomb des coteaux de Lormont, des navires à fort tirant d'eau attendent leur tour pour entrer dans la rade.
Une flotte impressionnante navigue autour des grands voiliers. Parfois, de petits canots le plus souvent à avirons, assurent le transport des voyageurs depuis les vaisseaux vers la berge. Quelques bateaux à voiles glissent sur le fleuve. Des filadières, reconnaissables à leurs carènes effilées, s'apprêtent à quitter le bord. À droite, l'équipage d'une yole lormontaise guinde le mât et s'apprête à appareiller. Lorsque l'embarcation aura quitté la rive, un filet, ou carrelet, sera immergé dans l'eau, afin de capturer les poissons de rivière. Plus au bord, des enfants profitent des joies de la baignade. Quelques barques, vidées de leur chargement sont échouées et attendent le changement de marée pour repartir. À l'aplomb des coteaux de Lormont, des navires à fort tirant d'eau attendent leur tour pour entrer dans la rade.
Par Cécile Navarra-Le Bihan. Extrait de Pierre Lacour : Le port de Bordeaux : Histoire d’un tableau. 2007. En vente à l’accueil
 Ce tableau a bénéficié, en 2007, d'un méticuleux travail de restauration grâce au soutien du Crédit Agricole d’Aquitaine. Michèle Bruneau (atelier de restauration de bois dorés du musée) a pris en charge la dorure du cadre en chêne massif. De style Louis XVI, le profil de la moulure s’inspire d’un cadre existant. Il a nécessité la pose de 750 feuilles d’or 23 carats.
Ce tableau a bénéficié, en 2007, d'un méticuleux travail de restauration grâce au soutien du Crédit Agricole d’Aquitaine. Michèle Bruneau (atelier de restauration de bois dorés du musée) a pris en charge la dorure du cadre en chêne massif. De style Louis XVI, le profil de la moulure s’inspire d’un cadre existant. Il a nécessité la pose de 750 feuilles d’or 23 carats.
Eugène Delacroix, "La Grèce sur les ruines de Missolonghi"
(Saint-Maurice, 1798 – Paris, 1863)
La Grèce sur les ruines de Missolonghi
1826
Huile sur toile
Hauteur 213 cm, largeur 142 cm.
Achat au Salon de la Société des Amis des Arts de Bordeaux, 1852
Byron et la guerre d'indépendance grecque
Lord Byron en tenue ottoname
Sous domination ottomane (turque) depuis le milieu du 15ème siècle, la Grèce se révolte en 1821. Si l'indépendance est proclamée dès 1822, lors de l'assemblée nationale d'Épidaure, les combats dureront en fait plus longtemps et il faudra attendre 1832 pour que soit créé officiellement le premier état grec.
Delacroix, Byron et la Grèce

Delacroix et l’histoire grecque

La Grèce sur les ruines de Missolonghi
Delacroix à Bordeaux

Dates principales de la vie d’Eugène Delacroix
Bibliographie sélective, à consulter à la bibliothèque du musée :
Eugène Delacroix, "La Chasse aux lions"
(Saint-Maurice, 1798 – Paris, 1863)
La Chasse aux lions
1854-1855
Huile sur toile.
Signé et daté en bas au centre : EUG. DELACROIX 1855
Hauteur sans cadre, 175 cm ; largeur sans cadre, 360 cm
Dépôt de l'Etat, 1856.
Collection du musée des Beaux-Arts, par transfert de propriété des oeuvres de l'Etat déposées à Bordeaux avant 1910, 2012.
La France de Napoléon III organisa sa première Exposition universelle des produits de l’industrie sur les Champs-Elysées ; elle souhaitait ainsi répondre au succès de celle organisée à Londres en 1851. La commission impériale répartit les « produits » entre deux sections distinctes : les produits de l’industrie et les cinq mille œuvres d’art retenues par un « jury mixte international ». A côté des écoles allemande, anglaise, belge, hollandaise, italienne ou suisse, la France occupait plus de la moitié du palais des Beaux-Arts situé entre la rue Marbeuf et l’avenue Montaigne. S’affirmant ainsi aux yeux du monde comme la nouvelle patrie des arts, l’Etat demanda alors aux gloires de son école - Ingres, Delacroix, Decamps et Vernet - de venir présenter leurs chefs-d’œuvre dans deux salons situés au centre de l’édifice. Seuls, les deux premiers peintres, supposés rivaux par l’opinion publique et les organisateurs, jouissaient chacun d’une salle entière, quoique Delacroix dut partager la sienne avec quelques confrères moins prestigieux.
Alors au faîte d’une carrière émaillée de scandales et de critiques véhémentes, Eugène Delacroix sélectionna trente-cinq toiles qui retraçaient trente-trois ans d’activité depuis La Barque de Dante (Salon de 1822, Paris musée du Louvre) jusqu’à la dernière commande de l’Etat passée un an plus tôt : La Chasse aux lions. Pour l’occasion, il « emprunta » quelques-unes d’entre elles à des musées et à des amis qui les possédaient. En revanche, la Chasse aux lions constituait une nouveauté pour laquelle l’Etat avait libre choix du thème à son auteur. Ce dernier avait sans doute murement réfléchi à son projet et, comme le laisse supposer son Journal, en avait négocié le thème en amont avec l’administration.
Delacroix s’intéressait à la représentation animalière depuis la fin des années 1840 et se rendait souvent au Jardin des plantes en compagnie du sculpteur Barye. Mais, il gardait à l’esprit les œuvres de son plus illustre prédécesseur : Pierre Paul Rubens (1577-1640). « Cabinet d’histoire naturelle, public les mardi et vendredi. Eléphants, rhinocéros, hippopotames, animaux étranges ! Rubens l’a rendu à merveille » (Journal, 19 janvier 1847).
Il est de tradition d’écrire que le peintre s’inspira de la Chasse aux lions du maître flamand que le musée de Bordeaux possédait depuis 1805. Il pouvait certes, sans revenir à Bordeaux, étudier l’œuvre à partir de la gravure de Soutman, mais nous savons, par une lettre, qu’il la trouvait inférieure à La Chasse à l’hippopotame de Munich. Un dessin du Louvre, daté de 1845, montre que Delacroix travaillait ce thème cynégétique à partir de la Chasse aux lions (v. 1621, Munich, Alte Pinacothek) dont le musée parisien possédait une copie dessinée pour la gravure de Schelte a Bolswert, mais aussi à partir des combats de l’Italien Antonio Tempesta (155-1630).
Entre avril et la fin de juillet, Delacroix composa sa scène à partir de nombreux dessins préparatoires, pour les groupes et la composition d’ensemble, et d’esquisses peintes, passant de masses colorées tournoyantes (Paris, musée d’Orsay) à une scène plus aboutie (Stockholm, Nationalmuseum) destinée au jury. Ce travail préparatoire, élaboré à partir du centre de la toile, permettait le passage de la demi-teinte au ton voulu pour donner un équilibre entre la spontanéité de l’esquisse, l’agencement chromatique et la lisibilité de la scène. A partir de l’œuvre de Rubens, Delacroix déconstruisit la composition originelle, qu’il trouvait trop désordonnée, afin de reconstruire et réarticuler les figures pour plus de lisibilité. L’imbrication des différents groupes et le mouvement violent des corps tournoyants constituent le sujet et l’originalité du tableau.
Le Journal indique précisément le début de la réalisation définitive, le 30 juillet, et témoigne de la remise en cause incessante de ses choix chromatiques. Malgré un effort soutenu, Delacroix n’acheva son œuvre que quelques jours avant l’ouverture de l’exposition le 15 mai.
Lorsque l’œuvre fut présentée, elle surprit tout le monde, par la violence du sujet et la vigueur de sa réalisation, et par l’éclat et la vigueur de sa palette : « La Chasse aux lions est une véritable explosion de couleur (que ce mot soit pris dans le bon sens). Jamais couleurs plus belles, plus intenses, ne pénètrent jusqu’à l’âme par le canal des yeux » écrivit Baudelaire dans un article du Pays le 3 juin 1855. De son côté, Paul Mantz critiqua la composition : « Seul le paysage est superbe ».
Quelques mois plus tard, l’Etat déposait l’œuvre au Musée de peinture et de sculpture de Bordeaux installé dans l’hôtel de ville, comme « pendant » de la Chasse de Rubens. Les visiteurs remarquaient l’entassement et la mauvaise visibilité de la collections dans les salons du rez-de-chaussée et dans les salles qu’occupait la Faculté depuis les années 1830. Un premier incendie se produisit dans l’édifice en 1862 et endommagea quelques œuvres. L’essentiel fut cependant préservé et gagna alors un « local en planches » (une galerie), au centre du jardin de l’hôtel de ville, pendant les travaux de réfection. Devant la dégradation des peintures, le conservateur décida de les rapatrier dans les salons dans l’attente du projet d’un nouveau musée. Par une fatalité déconcertante, un second incendie se déclara le 7 décembre 1870 et détruisit ou endommagea gravement trente-et-un tableaux, dont une majorité de grands formats, et endommagea quarante-sept autres. La Chasse de Rubens compta parmi les victimes du sinistre et celle de Delacroix subit des dégâts irrémédiables au point qu’elle resta dans un « magasin » municipal. Etant donné sa connaissance des techniques de son maître Delacroix, Andrieu proposa ses services pour la restauration dès 1871. Au terme de sept ans de consultation, il fut décidé de restaurer l’œuvre en l’état mais de la laisser en réserve. Entretemps, la Ville décida la construction d’un musée d’après les plans de son architecte Charles Burguet entre 1875 et 1881.
Cette toile reste capitale dans la carrière de Delacroix car, comme l’a rappelé Vincent Pommarède dans le catalogue Delacroix les dernières années, elle synthétise trois thèmes majeurs du peintre (orientalisme, chasse et représentation animalière) et résume ses principales préoccupations sur le mouvement, l’expression, la couleur et la technique. Le peintre s’était déjà essayé à ce sujet en réalisant en 1854 La Chasse au tigre (Paris, musée d’Orsay) commandée alors par le marchand Weill. Dans sa volonté de renouveler un sujet déjà traité, Delacroix peignit en 1858 une seconde version (Boston, Museum of Fine Arts) où il sépare les protagonistes dans un souci de clarté et en 1861 une dernière version (Chicago, Art Institute) plus nerveuse et au paysage plus prépondérant.
En choisissant un sujet traité par ses prédécesseurs flamands et italiens des XVIe et XVIIe siècles, mais aussi par des peintres français du XVIIIe siècle (Boucher, Oudry), Delacroix s’inscrivait dans une thématique fréquemment abordé. Mais en se mesurant à Rubens, il montre aussi sa propre perception de son rôle, sinon de sa place dans le panthéon des grands maîtres de la peinture européenne. Tout au long de sa carrière, Delacroix n’a eu de cesse de se mesurer aussi à ses illustres prédécesseurs (Léonard de Vinci, Raphaël, Rubens et Le Brun) et, par un curieux paradoxe, les ravages du feu ont renforcé les effets plastiques et dramatiques de cette œuvre.
La Chasse aux lions fut la dernière grande composition de Delacroix présentée au public. Dans son désir permanent de se renouveler, le peintre s’intéressa encore à cette représentation cynégétique en 1858 (Boston) et 1861 (Chicago). Malgré les nombreuses critiques, elle bénéficia rapidement d’une renommée auprès des amateurs et des artistes qui venaient l’étudier et la copier au musée de Bordeaux. Parmi eux, figurèrent Andrieu, le paysagiste Daubigny, le jeune Odilon Redon (1867, musée d’Orsay, dépôt au musée des Beaux-Arts de Bordeaux et Winterthur, Kunstmuseum) ou, moins connus, J. Coudray (Bordeaux, musée des Beaux-Arts) et le baron de Gervain (idem). Malgré le sinistre, elle continua à inspirer certains contemporains à l’instar d’un Charles Dufresne (vers 1929, Musée national d'art moderne, Paris, déposé au musée des Beaux-Arts de Bordeaux).
Rinaldo CARNIELO, "Mozart expirant"
(Boscomontello-Biadone, 1853 – Florence, 1910)
Mozart expirant
1877-1880
Ronde-bosse en marbre
Hauteur 150cm, largeur 93cm, profondeur 150cm
Dépôt de l’Etat en 1890.
Antoine-Louis BARYE, "Panthère saisissant un cerf"
Paris, 1796-1875
Panthère saisissant un cerf
Achat de la ville en 1857
Bronze à patine brune

Jean Louis Ernest MEISSONIER, "Cheval au trot"
(Lyon, 21 février 1815 – Paris, 31 janvier 1891)
Cheval au trot
Bronze fondu d’un seul jet avec patine par oxydation
40 x 60 cm
Fondeur – éditeur : Siot-Decauville, n°1.
[1] D’après les recherches menées par Evelyne Helbronner (thèse de doctorat, Paris IV, 2003).
[2] Catalogue de la sculpture française de 1850 à 1914 dans les musées et collections publiques du nord de la France.
Auguste Rodin (1840-1917)

Cybèle
En 1883, Auguste Rodin participe au Salon de la Société des Amis des Arts de Bordeaux. L'exposition organisée sur les Terrasses du Jardin-Public est, comme chaque année depuis 1851, l'événement artistique majeur de la Ville.
Il faudra attendre vingt-trois ans pour retrouver une œuvre de Rodin à Bordeaux. Mais en 1906, cette seconde participation se solde par l’achat de la municipalité du grand plâtre, inscrit au catalogue de l’exposition sous le numéro 542, Figure assise. C’est un succès, mais un succès acquis à moindres frais si l’on compare la dépense de 500 frs pour l’œuvre de Rodin à celle de 8000 frs pour Jeunesse en rose, tableau d’Alfred Roll. Cette acquisition reste toutefois une exception et place Bordeaux dans les premières villes à faire l’acquisition d’une œuvre d’Auguste Rodin pour son musée. (Cybèle : en savoir +…)
À l'image des salons parisiens, l'exposition de la Société des Amis des Arts de Bordeaux présente "les ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants". Mais, malgré une volonté de présenter les productions artistiques les plus diverses, la peinture garde une place de premier choix et relègue les autres domaines, comme la sculpture, au deuxième rang de la manifestation, conformément au goût du public. L'occasion toutefois, pour les artistes locaux, de rencontrer les œuvres et les créateurs de plus grande renommée.
La présence de Rodin à Bordeaux permet aux sculpteurs de découvrir l’artiste à l’origine de tant de controverses. De L’Âge d’airain, en 1877, où on l’accuse de moulage sur le motif, à son Victor Hugo, en 1896, représenté nu, ou encore en 1898, son Balzac bouleversant les représentations classiques des « grands hommes », Auguste Rodin incompris, déchaîne la critique. Par contestation, il organise à Paris, à l’écart de l’Exposition Universelle de 1900, une présentation de 150 de ses sculptures. Le succès est immédiat et les commandes affluent. Pour faire face à la demande, Rodin doit trouver de l'aide pour réaliser une partie de son travail. Il fait appel à ses élèves (Camille Claudel) et à quelques sculpteurs dont il reconnaît les compétences, dont la « Bande à Schnegg ». (Bande à Schnegg : en savoir +…)

Albert MARQUET "Portrait de Matisse "
(Bordeaux, 26/03/1875- Paris, 14/06/1947)
"Portrait de Matisse "
Huile sur toile, hauteur sans cadre 61cm, largeur sans cadre 50cm.
Historique : Achat de la ville 2011.
Cette période de travail en commun date de leur apprentissage à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts dans l’atelier de Gustave Moreau, dans les années 1896-1898 et se prolonge dans les années 1903-1904, pour laisser place à une amitié indéfectible, comme on en connaît peu entre deux artistes et dont leur correspondance fait foi.
Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux dont la collection d’œuvres de Marquet, originaire de Bordeaux, est l’un des points forts de son XXème siècle, conserve le témoignage de ce travail à travers le Nu dit Nu fauve de 1899 ainsi qu’à travers les œuvres de Matisse de la collection de Marquet mise en dépôt par le MNAM.
La présence de ce Portrait de Matisse dans les collections du musée de Bordeaux renforce ce moment historique dans l’histoire de la peinture qui donnera naissance au fauvisme.
Lors de l’exposition d’été « Matisse-Marquet. Correspondances », en 2009 ce portrait a été une révélation par l’évidence de sa modernité, dans cette économie de moyen grâce à laquelle Marquet annonce la stature de son ami.
Mary CASSATT, "Portrait de fillette"
(Allegheny City, 1844- Mesnil-Théribus (Oise), 1926)
Portrait de fillette ou La robe de dentelle
Huile sur toile, 1879.
Historique : Ancienne collection René DOMERGUE.